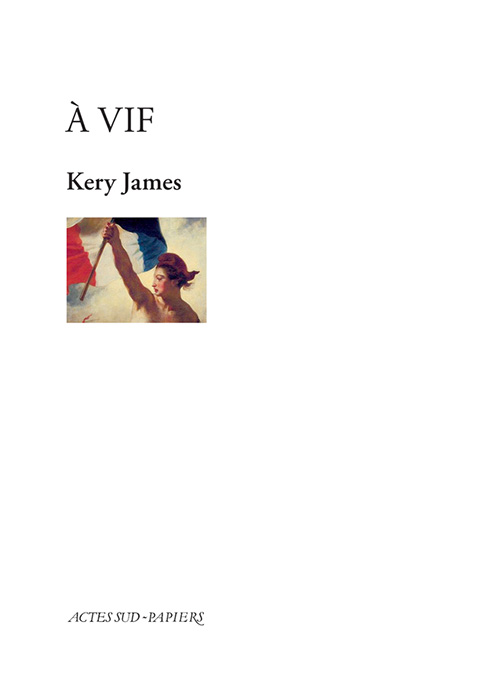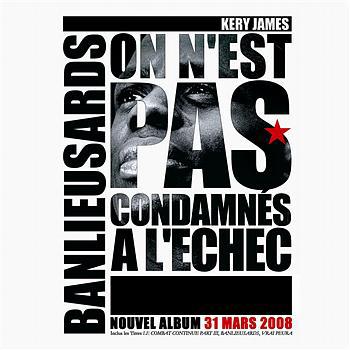"Banlieusard et fier de l’être" : Kery James, ou le retournement "à vif" du stigmate spatio-symbolique
« Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l’être,
Quand tu m’vois, tu mets un visage sur c’que l’autre France déteste. »
Kery James, Lettre à la République.
Dans son actualité artistique récente, le rappeur orlysien Kery James((Alix Mathurin, alias Kery James, est né en Guadeloupe en 1977, de parents haïtiens. Il arrive en France au milieu des années 1980 et grandit à Orly, dans le Val-de-Marne (94). Sa vocation pour le rap se développe à l’adolescence, au fil d’ateliers d’écriture organisés par la Maison des jeunes et de la culture (MJC) d’Orly, animés, entre autres, par le rappeur franco-sénégalais MC Solaar. Souvent rattachée au courant du « rap conscient », sa musique évoque les inégalités, les discriminations et les aspects multiformes de la violence sociale en général. En ce sens, Kery James est un « mauvais rappeur », c’est-à-dire un rappeur considéré comme peu fréquentable par les médias mainstream, puisqu’il évoque des sujets controversés (Béru, 2008). Son attachement pour le « 9-4 », le département du Val-de-Marne, souvent évoqué dans ses chansons, ne s’est jamais démenti depuis comme en témoignent notamment de très nombreuses interventions auprès des élèves du collège Robert-Desnos d’Orly depuis plusieurs années. Pour un exemple récent, voir la vidéo « Kery James anime un atelier d’écriture pour les collégiens d’Orly », mise en ligne par le département du Val-de-Marne en avril 2017 [consulté en août 2017].)) propose une pièce de théâtre écrite par ses soins, sous le titre « À Vif », à l’affiche, entre autres, du Théâtre du Rond-Point((Jouée au Théâtre du Rond-Point entre le 10 et le 28 janvier 2017, la pièce a été reconduite du 12 septembre au 1er octobre de la même année, en raison de son succès. La pièce, qui a également été représentée dans toute l’Île-de-France et dans le reste du pays, vient de connaître une édition chez Actes Sud (Kery James, 2017).)). Le rap s’invite, pour l’occasion, dans l’un des plus prestigieux théâtres de Paris, à deux pas des Champs-Élysées, et confirme ainsi un peu plus sa trajectoire de légitimation((La trajectoire de légitimation du rap, c’est-à-dire l’appropriation de cette production culturelle, originellement peu légitime, par les élites culturelles, se fait à deux niveaux. D’une part, celles-ci n’hésitent plus à louer les qualités littéraires de certaines chansons, comme en témoignent par exemple les articles de l’essayiste Thomas Ravier sur le rappeur Booba publiés dans la Nouvelle Revue française (Ravier, 2003 ; Ravier, 2012). D’autre part, celles-ci n’hésitent plus à en faire une documentation de premier choix dans une perspective de sciences sociales, comme l’illustre par exemple la thèse de géographie, récemment soutenue, de Séverin Guillard (Guillard, 2016). À cet égard, le séminaire d’élèves « La Plume et le Bitume », organisé à l’ENS Ulm depuis janvier 2015, peut paraître emblématique des deux modes d’appropriation.)). La pièce met en scène la joute oratoire entre deux jeunes avocats, que tout oppose socialement, lors du concours d’éloquence de la Petite Conférence de l’École du barreau de Paris. La thématique de l’agôn est la suivante : « L’État est-il le seul responsable dans la situation actuelle des banlieues en France ? ». Kery James incarne – comme pour mieux jouer son propre rôle – un transfuge de classe originaire d’Orly, Soulaymaan, qui défend paradoxalement la thèse selon laquelle « les citoyens sont responsables de leur condition », en érigeant sa réussite individuelle en modèle, tandis que Yannick Landrein figure le personnage de Yann, issu d'une famille aisée, qui semble vouloir racheter son enfance cossue en pointant du doigt les négligences coupables de l’État. Le spectateur est invité, de manière fort séduisante (le jeu d’acteur étant, en particulier, très poignant, à mi-chemin des codes du théâtre et de ceux de la battle de rap), à osciller entre la thèse et l’antithèse, sans qu’un arbitrage n’ait véritablement lieu – sans, surtout, que les termes du débat ne soient analysés, que ce soit la notion d’ « État », confondue avec celle de dirigeants politiques, mais surtout l’expression « situation actuelle des banlieues en France », qui mêle considérations économiques, religieuses et raciales sur fond d’appartenance territoriale symbolique. Nous proposons de revenir brièvement sur ce second point, à partir d’une analyse générale de la thématique des « deux France » dans l’œuvre de Kery James, laquelle se structure essentiellement autour de l’emploi du mot « banlieusard ».
Les « deux France » de Kery James, incarnées, au théâtre du Rond-Point, dans un duo d’acteurs
L'affiche de la pièce de Kery James au Théâtre du Rond-Point. Source : site officiel de l'auteur. |
Les « deux France » de Kery James, ou la mise en espace binaire des antagonismes sociaux.
Dans la pièce À Vif, le spectateur retrouve, incarnée dans un duo d’acteurs, une « bipolarisation sociale » (Vieillard-Baron, 2006) qui traverse durablement la pensée artistique de Kery James : l’antagonisme entre ce que le rappeur nomme « les deux France », opposition fondamentale entre un « eux » et un « nous »((Pour Richard Hoggart (Hoggart, 1970 [1957]), cette vision duale du monde social est emblématique des classes populaires. Au milieu des années 2000, Joël Roman met déjà en avant l’existence de cette vision binaire chez ceux qu’il nomme, sans remettre en question cette appellation, « jeunes de banlieue » (Roman 2013 [2007]))), qui voit se confronter une France privilégiée, que le rappeur ne nomme jamais((Les études sur les stigmatisations raciales montrent que les processus d’identification ne sont « ni symétriques, ni équivalents », dans la mesure où le « majoritaire (celui qui majore sa position) se pense [et réussit à être pensé] comme le référent universel et par rapport auquel s’ordonne la hiérarchie des Autres » (Poiret, 2011). Ainsi, seul celui qui s’écarte de la norme dominante, pensée tacitement comme universelle, bénéficie généralement d’un qualificatif dépréciatif marquant son « altérité ».)), et une France délaissée, dite « banlieusarde », à laquelle le rappeur s’identifie toujours. Sur la base d'une « mise en espace » du social (Gintrac et Mekdjian, 2014, p. 236), l’opposition France banlieusarde / France non-banlieusarde ou, pour nommer la seconde, France des banlieues / France des beaux quartiers((Pour « inverser le sens de l’étonnement » et de la catégorisation de l’ « altérité », Nicolas Jounin conduit, lors de promenades sociologiques, des étudiant.e.s de Seine-Saint-Denis dans les « beaux quartiers » ou « quartiers bourgeois » parisiens (Jounin 2016).)), est considérée comme le strict décalque de l’antithèse dominants / dominés, en vertu d’une « spatialisation » (Tissot et Poupeau, 2005) flagrante et étroitement binaire des antagonismes sociaux, que ceux-ci soient économiques, religieux ou même, parfois, raciaux. La Lettre à la République (2012), manifeste de rupture franche avec la vie politique française((Dans ce morceau, comme dans la pièce À Vif, le rappeur revient notamment sur le caractère stigmatisant des discours médiatico-politiques : « De vrais voyous en costard, bande d’hypocrites ! / Est-ce que les Français ont les dirigeants qu’ils méritent? / Au cœur de débats, des débats sans cœur / Toujours les mêmes qu’on pointe du doigt dans votre France de rancœur / En pleine crise économique, il faut un coupable […] / Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques / Et vous attendez de nous qu’on s’écrie “Vive la République!” ».)), semble en l'occurrence opposer frontalement une France « banlieusarde », métissée d’« Arabes et de Noirs » et « musulmane », à une France « blanche », « islamophobe […] sous couvert de laïcité » plutôt que dotée d’une confession propre((Cette France « blanche », que le rappeur apostrophe dans la Lettre à la République, est présentée comme « raciste » parce qu’héritière non repentie du colonialisme, comme le montre l’extrait suivant : « Ce passé colonial c’est le vôtre / C’est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre / Maintenant vous devez assumer / L’odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez ». Incontestablement, l’œuvre de Kery James mériterait, pour compléter le propos, d’être analysée à l’aune de la « fracture coloniale » française (Blanchard et al., 2006 ; Béru, 2008).)). Ainsi la triade identitaire « noir, musulman, banlieusard », dont le rappeur se revendique avec fierté dans ce même morceau, est-elle tacitement considérée comme le contre-modèle, minoritaire et persécuté, d'un ensemble identitaire dominant au sein de la société française, l’espace constituant symboliquement la « dimension du social » (Veschambre, 2006) où s’exprime avec prédilection la séparation radicale entre « deux France ». Dans ce contexte, Kery James évoque son parcours personnel, en usant d’images frappantes pour décrire une contre-société, en guérilla larvée dans des territoires abandonnés par la Nation :
« On ne s’intègre pas dans le rejet,
On ne s’intègre pas dans les ghettos français,
Faut être sensés.
[…]
J’ai grandi à Orly dans les favelas de France,
J’ai fleuri((Ou « fleury », selon certaines transcriptions, qui veulent voir une syllepse de sens entre le verbe « fleurir » et le toponyme Fleury, en référence à la commune de Fleury-Mérogis dans l’Essonne (91), réputée pour accueillir le plus grand centre pénitentiaire de France, et même d’Europe.)) dans les maquis, j’suis en guerre depuis mon enfance. ».
Dans Banlieusards (2008) et Zyed et Bouna (2015) – hommage musical diffusé sur YouTube dans une version inachevée, dix ans après la mort tragique des deux adolescents –, la « bipolarisation sociale » semble cependant plus nuancée, même si la thématique des « deux France » est omniprésente, comme en témoigne un extrait du premier titre :
« Parce qu’à ce jour y’a deux France, qui peut le nier ?
Et moi, je serais de la deuxième France, celle de l’insécurité,
Des terroristes potentiels, des assistés. »
Dans ces deux chansons, la dichotomie banlieusard / non-banlieusard est plutôt employée pour exprimer des antagonismes strictement socio-économiques. Les dissensions religieuses et raciales semblent quant à elles évacuées, puisque le rappeur dédicace son morceau Banlieusards à « [s]es babtous [verlan de « toubab », terme sénégalais pour désigner les « Blancs »], prolétaires et banlieusards », de même que Zyed et Bouna évoque « tous les pauvres […] mépris[és] » par les élites.
|
|
Couverture de l'édition de la pièce À vif parue chez Actes Sud
|
Extrait du clip de Lettre à la République (2012)
|
|
|
Soucieux de la place des « banlieusard(e)s » dans la République, Kery James évoque souvent ses symboles, à l’image de Marianne, tantôt de manière conventionnelle, tantôt de manière détournée. Sources : présentation du livre chez Actes Sud ; capture d'écran du clip réalisé par Leïla Sy et Mathieu Foucher. |
|||
D’une manière générale, l’opposition entre les « deux France » qui structure l’œuvre du rappeur Kery James s’exprime donc de manière spatio-symbolique, en raison de la référence permanente((La plupart du temps, cette référence est indirecte puisqu’insinuée par le terme « banlieusard », dont la version extensive est le génitif « de banlieue ». Elle s’accompagne de nombreux « effets de réel », qui s’appuient sur la figure du « lâcher de noms » (name dropping), c’est-à-dire la mention de toponymes réels, généralement dépréciés symboliquement.)) à une « banlieue » abstraite et essentialisée, toponyme « vague susceptible de s’appliquer à tout secteur enclavé et à toute population qui s’écarterait de la norme » (Vieillard-Baron, 2006). Cette ligne de rupture tend à recouper systématiquement des fractures économiques, mais aussi parfois, non sans ambiguïtés, des fractures religieuses voire raciales((Ne serait-ce que parce que les catégorisations raciales et religieuses demeurent omniprésentes dans les textes de Kery James. Comme Cécile Gintrac et Sarah Mekdjian lorsqu’elles critiquent les œuvres de certains géographes médiatiques, on peut parfois se demander si ce n’est pas « sous couvert de l’espace, que l’entrée ethnique et raciale est légitimée comme un critère pertinent » (Gintrac et Mekdjian, 2014, p. 236-237). Dès le début des années 2000, Jacqueline Costa-Lascoux notait : « La référence topographique se surajoute, aujourd’hui, à la catégorie ethnique. » (Costa-Lascoux, 2001, p. 130).)). La construction de ce référent spatial stéréotypé passe notamment par l’emploi de mots-stigmates, porteurs de connotations fortes comme « ghetto » ou « favela » (Wacquant, 1992 ; Vieillard-Baron, 1994)((Les démarches du géographe Hervé Vieillard-Baron et du sociologue Loïc Wacquant, conduites depuis plusieurs décennies dans leurs champs disciplinaires respectifs, peuvent être mise sur le même plan. Tous deux s’attachent à critiquer les emplois flottants (et stigmatisants) des termes « banlieue », pour le premier, et « ghetto », pour le second, auxquels ils souhaitent conférer une définition conceptuelle rigoureuse pour les rendre opératoires en sciences sociales. Selon Loïc Wacquant, l’usage du terme « ghetto » pour décrire la situation des zones urbaines françaises les plus défavorisées depuis les années 1980 mêle ainsi « confusion conceptuelle et amnésie historique », puisqu’il conduit à mettre sur le même plan les résultats d'une « ségrégation involontaire », résultant en premier lieu d’inégalités économiques et de solidarités migratoires, et ceux d’une « ségrégation [raciale] volontaire » caractéristique du ghetto dans son acception restreinte (Wacquant, 2005, p.16-17).)), ou encore par la convocation d’images-stigmates comme, par exemple, le grand ensemble. Ainsi, au cours de la représentation d’À Vif au Théâtre du Rond-Point, le spectateur assiste à la projection, en arrière-plan, de la photographie d’une barre d’immeuble grisâtre, anonyme, qui finit – comme pour mieux incarner l’angoisse – par s’enflammer. Pour Kery James, l’identité « banlieusarde », expérience sociale minoritaire, mise sur le même plan que la « condition noire » (Ndiaye, 2009) ou que la « condition musulmane », fait donc symboliquement frontière entre deux blocs sociaux antagonistes que toutes les caractéristiques sociales opposent par ailleurs au sein de la Nation. En retournant cette identité-stigmate à des fins militantes, le rappeur « fabriqu[e] un mythe mobilisateur renforçant l’image (fausse ?) du groupe territorialisé en tant que totalité unifiée, au-delà même de ses diversités et de ses clivages réels » (Di Méo, 2002, p. 178). Il emprunte, par la même occasion, une grille de lecture du social sujette à un prisme spatialiste rigide, qui ne prend pas compte la pluralité du réel, en particulier la grande complexité des banlieues françaises (Vieillard-Baron, 2011)((Comme le souligne Jérémy Robine : « La moitié des Français vivent [selon les statistiques de l’Insee] en banlieue. Cependant, lorsqu’on parle des “banlieues”, ce ne sont pas eux que l’on évoque […]. » (Robine, 2013, p. 132).)).
|
Kery James le 31 mars 2013. Source de l'illustration : Dmdstyle, sous licence CC Attribution 3.0. (voir dans Wikimedia Commons) |
La fabrique du stigmate spatio-symbolique « banlieusard ».
Dans son œuvre, le rappeur Kery James retrouve, en l’inversant, la logique binaire des discours politico-médiatiques lorsqu’ils se laissent aller à la facilité de la stigmatisation socio-territoriale (Wacquant, 1992 ; Gintrac et Mekdjian, 2014). Ce processus est bien connu puisque de nombreuses études, à mi-chemin de la sociologie critique et de la géographie sociale, insistent sur la construction du stigmate « banlieusard » comme identité assignée à distance, pour reprendre une expression prisée de la « socio-histoire » de Gérard Noiriel((S’inspirant de la sociologie de Norbert Élias, Gérard Noiriel s’intéresse aux « liens à distance » et aux « moyens d’action à distance » qui s’exercent entre les individus, par l’intermédiaire des médias ou des normes juridiques, par exemple. (Noiriel, 2006.))). Aussi la focale ne porte-t-elle pas – comme c’est parfois le cas (Léonard 2015) – sur un stigmate socio-résidentiel, susceptible de se manifester dans les interactions quotidiennes par des discriminations causées du fait de son adresse personnelle ou de son lieu de vie (qu’il s’agisse par exemple des relations avec la police, les services sociaux ou encore de l’administration judiciaire), mais sur un stigmate spatio-symbolique, construction symbolique de la différence entre groupes sociaux basée sur la dépréciation d’un « référent géographique identitaire » (Stock, 2006, p.11). Autrement dit, l’analyse s’éloigne en partie de l’orthodoxie goffmanienne, qui pense principalement la stigmatisation dans le cadre des interactions directes entre individus (Plumauzille et Rossigneux-Méheust, 2014), pour mener à bien celle d’une « représentation » sociale, « oblig[eant] à penser la construction des identités, des hiérarchies et des classements comme le résultat de "luttes de représentations" » (Chartier, 2013). Les critiques des discours médiatiques, inspirées des travaux de Patrick Champagne (Champagne, 2015 [1990]), mettent tout d’abord en évidence la production durable d’un « lieu commun journalistique » ou « banlieue du 20 heures » à partir d’une ethnologie du travail journalistique (Berthaut, 2008 ; Berthaut, 2013 ; Sedel, 2013 ; Sedel, 2014) ou d’une analyse de corpus documentaires médiatiques (Rivière et Tissot, 2007 ; Gaudin, 2015). Ces analyses révèlent la contribution, ininterrompue depuis plusieurs décennies, du champ médiatique à la fabrication de stéréotypes sur certains groupes sociaux dits, souvent d’ailleurs sans considération de leur lieu de résidence et de leurs lieux de vie, « de banlieue » (jeunes adolescents et adulescents urbains de sexe masculin, populations de confession musulmane, rappeurs et footballeurs, chômeurs, femmes voilées, etc.)((Le cas de la médiatisation de l’« affaire Benzema » à l’automne et à l’hiver 2015 est, à cet égard, exemplaire (Beaud et Oualhaci, 2016).)). Nul doute que l’effet d’entraînement ne soit en partie redevable des mutations socio-économiques du monde médiatique (Sedel, 2013), qui semblent renforcer toujours plus la course à l’audimat et la précarité des conditions du travail journalistique (Bourdieu, 1996)((En nous inspirant de ce corpus théorique et empirique, nous avons tenté succinctement, dans une revue étudiante, de mettre en œuvre cette pensée critique pour analyser la médiatisation particulièrement intense, et souvent stigmatisante à l’égard de « la banlieue », des suites des attentats parisiens de janvier 2015, en particulier la marche républicaine du 11 janvier (Burgel, 2016).)).
En dehors des effets propres au champ médiatique, certains analystes montrent que la fabrique de la « peur des banlieues » (Vieillard-Baron, 2000) s’inscrit dans une séquence historique ayant conduit, depuis les années 1970, à la « retraduction, en des catégories spatiales, de la question sociale » (Tissot et Poupeau, 2005, p. 7)((Pour prendre un exemple récent, on peut penser à l’interprétation spatialisante qui fut très rapidement employée pour expliquer les attentats parisiens de janvier 2015. En effet, lors de ses vœux à la presse du 20 janvier, soit quelques jours seulement après les attentats, le Premier ministre de l’époque, Manuel Valls, évoque un « apartheid territorial, social [et] ethnique ». Source : Le Monde, 20 janvier 2015. [consulté en septembre 2017])). Des auteurs s’attachent ainsi à souligner le rôle primordial de l’État dans la fabrique d’un stigmate spatio-symbolique « banlieusard », en critiquant tout particulièrement les « politiques de la ville » (Kirzbaum et al., 2015), accusées de renforcer le « problème des banlieues » ou « crise des banlieues » (Stébé, 2010) plutôt que d’y apporter des solutions objectives. À cet égard, l’évolution de l’État social français aurait connu, selon Renaud Epstein, une « radicalisation et une racialisation jacobine » suite aux émeutes de 2005, en raison de la transposition d’une vision « néoconservatrice » dans les politiques publiques dédiées à la ville (Epstein, 2016, p. 3). Pour Cyprien Avenel, il est plus structurellement problématique que les « politiques de la ville », pensées originellement comme « un levier pour rendre plus efficaces les politiques publiques dites de "droit commun" (emploi, éducation, santé, sécurité, logement) », aient finalement eu tendance, au fil des décennies, à se substituer à ces dernières (Avenel, 2013, p. 6), au risque du déclassement des populations concernées. Jérémy Robine insiste, de son côté, moins sur les effets de différenciation juridique engendrés par les politiques de la ville que sur les ambiguïtés sémantiques des objectifs mêmes assignés à ces politiques, en affirmant que « l’unité des banlieues à problèmes n’existe […] qu’au travers de cette représentation qu’elles pos[ent] et de l’existence d’une politique publique dédiée à sa résolution » (Robine, 2013, p. 132 ; Robine, 2016).
|
prospectus publicitaire diffusé à l'occasion de la sortie de l'album « À l'ombre du show business » (2008) contenant la chanson « Banlieusards ». |
Kery James a créé en décembre 2007 l’association A.C.E.S. (Apprendre, Comprendre, Entreprendre, Servir) dont le slogan « Banlieusards, on n’est pas condamnés à l’échec » a été repris dans la chanson « Banlieusards », qui lui sert de manifeste. L’association vise notamment à soutenir les jeunes « banlieusard(e)s » méritants au travers de démarches de soutien scolaire, de voyages éducatifs et de bourses d’études. Voir la page sur le site de l'artiste. |
De la nécessité de l’étude du retournement du stigmate spatio-symbolique
De manière surprenante, malgré les précieux enseignements de tous les travaux portant sur la « production institutionnelle » (Plumauzille et Rossigneux-Méheust, 2014, p. 220) du stigmate spatio-symbolique « banlieusard », le processus de retournement du stigmate, théorisé par les travaux les plus emblématiques de l’interactionnisme symbolique (Goffman, 1975 [1963]), est – sauf exceptions notables (Lepoutre, 1997 ; Piolet, 2016) – très rarement évoqué, si bien que l’analyse peut, en un sens, sembler souvent assez misérabiliste (Grignon et Passeron, 2015 [1989]) dans sa description univoque d’une violence symbolique, certes indéniable, des institutions médiatiques et politiques. Cette plus grande discrétion analytique est sans doute liée au fait qu’il peut sembler plus légitime, pour le.la chercheur.euse en sciences sociales, de déconstruire les discours dominants que de désenchanter ceux des populations stigmatisées. Le risque est toutefois grand de passer à côté des revendications identitaires qui se greffent sur la construction de ce stigmate spatio-symbolique, dans la mesure où toute construction identitaire oscille très largement, lorsqu’elle se cristallise (et donc prend racine), entre les deux pôles primordiaux de l’« assignation » et de la « reconnaissance », comme le rappelle Didier Fassin (Fassin, 2010)((Un troisième pôle étant celui de l’ « objectivation », dont il ne convient pas de parler dans un cadre aussi restreint. On peut cependant se contenter de suggérer que les « politiques de la ville », à la collusion des discours médiatico-politiques et des savoirs administratifs ou sciences d’État, jouent un rôle dans le pôle de l’« assignation » comme dans celui de l’« objectivation ».)).
L’œuvre du rappeur Kery James, qui annonce la parution d’une autobiographie intitulée Banlieusard et fier de lettres à l’automne 2017 tout en ayant lancé le site d’information LeBanlieusard.fr ((Évoquant le « rapport parfois insidieux entre les médias et le pouvoir politique et tendancieux entre le médias et le pouvoir financier », ce site se veut un « média alternatif, indépendant et sérieux dans lequel l’information est traitée avec un point de vue différent ». Comme le montre la devise « L’information par nous, pour tous », le projet vise à donner voix aux « banlieusards », cependant sans esprit de fermeture. La création de ce site, en pleine campagne des élections présidentielles, fait suite à la publication d’une tribune par Kery James dans le journal Le Monde en février 2017 pour dénoncer les violences policières. Voir la page présentation du site datée du 18 avril 2017.)) depuis le mois d’avril de la même année, témoigne de la prégnance des réappropriations du référent identitaire « banlieusard », en dépit (mais aussi en raison même) de sa dépréciation, comme « support spatial symbolique » d’une construction identitaire (Brun, 2016 [1983], p. 62-63)((Réfléchissant, au début des années 1980, au concept de « territorialisation » dans le cadre du séminaire de la rue d’Ulm de Marcel Roncayolo, éminent spécialiste de géographie urbaine, son élève Jacques Brun (Brun, 2016 [1983]) évoque la possibilité que certaines « représentations collectives » d’un territoire soient conduites à « acquérir assez de force pour s’affranchir, à la limite, de leur base matérielle », au point que le « support spatial symbolique » de ces représentations devienne « territoire imaginaire ». L’auteur pense au cas des sociétés diasporiques, dont la patrie d’origine peut parfois devenir un référent identitaire dénué de matérialité, par exemple lorsque les mobilités entre la patrie d’accueil et celle-ci s’amenuisent au fil des générations. Le propos semble pouvoir aisément se transposer à la question qui nous intéresse.)). À cet égard, le rap mérite sans conteste d’être pris au sérieux par les sciences sociales, en particulier la géographie, du fait de la prégnance des représentations territoriales qu’il véhicule : comme le souligne en effet Séverin Guillard, le genre même du rap est indissociable de « revendications spatiales » (Guillard, 2017), qui permettent à l’artiste de remplir un impératif d’authenticité et de représentativité (Béru, 2008). Ainsi qu’invite à le faire l’auteur (Guillard, 2016, 2017), il conviendrait alors de compléter l’analyse de l’ « imaginaire géographique » de Kery James par celle de sa pratique des « scènes musicales » (ensembles de normes artistiques en vigueur dans un contexte social et dans un cadre spatial donnés), en étant notamment attentif à la spatialité de ses interventions artistiques.
Conclusion
En définitive, on peut se demander si la représentation du social exprimée dans les « deux France » de Kery James ne relève pas de cette tendance à spatialiser rigidement les antagonismes sociaux dont témoignent même les sciences sociales (Ripoll et Rivière, 2007 ; Rivière, 2013 ; Delpirou, 2017). Substituer des territoires à des acteurs, ou plutôt compartimenter les acteurs par zones territoriales selon tel ou tel critère discriminant, est plus que tentant pour lire le monde social, dans la mesure où la démarche a le mérite de la clarté et de la lisibilité. Comme le souligne Guy Di Méo, « si la société se perçoit difficilement derrière les individus qui la composent, le territoire, lui, se cartographie et se borne » (Di Méo, 2002, p. 178). Autrement dit, il n’existe pas de représentation aussi claire que la carte géographique, « image [plane,] concrète [et] stabilisée » construite, mentalement ou matériellement, pour lire l’espace (Palsky, 2004), qui soit susceptible de donner à voir une société, notamment dans la fluidité de ses groupes sociaux. « Intériorisé[e] dans des schèmes de perception » (Ripoll, 2012, p. 121), cette « mise en espace du social » semble, à l’exemple du stigmate « banlieusard », avoir connu une diffusion du sommet à la base de la pyramide sociale, des stigmatiseurs aux stigmatisés, selon des modalités et des rythmes qui demeurent à étudier dans une perspective historique((L’enjeu est celui d’une « histoire contextualisée de la production, de la réception et de la perception des stigmates » (Plumauzille et Rossigneux-Méheust, 2014, p. 218))). Comme le soulignait Pierre Bourdieu dans les Méditations pascaliennes (Bourdieu, 1997, p. 204), la première des violences symboliques n’est-elle pas alors cette « adhésion que le dominé ne peut manquer d’accorder au dominant (donc à la domination) lorsqu’il ne dispose pour le penser et pour se penser […] que d’instruments de connaissance qu’il a en commun avec lui » ? En effet, si la dimension foncièrement militante du retournement du stigmate spatio-symbolique par Kery James ne saurait faire de doute((Ce « renversement positif des identités infâmantes », qui permet de « valoriser l’identité à l’origine de l’exclusion [pour] donner un contenu positif à cette spécificité », tout en favorisant la mobilisation et la formation d’une conscience de groupe (Roussel 1995), a été particulièrement bien analysé pour le mouvement LGBT (Broqua 2006).)), cette démarche n’en conduit pas moins à demeurer tributaire d’éléments de langage, qui sous-tendent une perception de la société jamais remise en cause.
L’auteur remercie Jean-Baptiste Dagorn, Alexandra Hondermarck, Marion Messador et Nathanaël Travier qui, à un moment ou à un autre, ont relu une version de cet article. Par ailleurs, il tient à exprimer toute sa considération (et même, peut-être, son admiration) à l’égard de la démarche artistique et citoyenne de Kery James : s’accorder le temps et l’énergie d’une réflexion critique était, d’une certaine manière, le moyen de reconnaître le grand intérêt de son œuvre. Enfin, merci à Jean-Benoît Bouron pour la qualité de son travail éditorial.
Bibliographie
- Avenel, Cyprien. 2013. « La politique de la ville en quête de réforme ». La Vie des idées [revue en ligne].
- Beaud Stéphane et Oualhaci Akim. 2016. « Sports populaires, sportifs impopulaires. L’ “affaire Benzema” remise en perspective ». La Vie des idées [revue en ligne].
- Berthaut, Jérôme. 2008. « La mise en image du “problème des banlieues” au prisme de la division du travail journalistique ». Revue Agone, n° 40, p. 109-130.
- Berthaut, Jérôme. 2013. La Banlieue du “20 heures”. Ethnographie de la production d’un lieu commun journalistique. Marseille, Éditions Agone.
- Béru, Laurent. 2008. « Le rap français, un produit musical postcolonial ? ». Volume !, n° 6, p. 61-79.
- Blanchard, Pascal, Bancel, Nicolas et Lemaire, Sandrine. 2006. La Fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial. Paris, La Découverte.
- Bourdieu, Pierre. 1996. Sur la télévision. Paris, Raisons d’agir.
- Bourdieu, Pierre. 1997. Méditations pascaliennes. Paris, Seuil.
- Brun, Jacques. 2016 [1983]. « “Territorialité” et analyse géographique de l’espace. Quelques remarques à propos du texte de M. Roncayolo », p. 61-66 in Roncayolo, Marcel et Ozouf-Marignier, Marie-Vic (dir.). Territoires. Paris, Éditions de la rue d’Ulm.
- Broqua, Christophe. 2009. Agir pour ne pas mourir ! “Act up”, les homosexuels et le Sida. Paris, Presses de SciencesPo.
- Champagne, Patrick. 2015 [1990]. Faire l’opinion. Le nouveau jeu politique. Paris, Éditions de Minuit.
- Chartier, Roger. 2013. « Le sens de la représentation ». La Vie des idées.
- Costa-Lascoux, Jacqueline. 2001. « L’ethnicisation du lien social dans les banlieues françaises ». Revue européenne des migrations internationales, vol. 17, n° 2, p. 123-138.
- Delpirou, Aurélien. 2017. « L’élection, la carte et le territoire : le succès en trompe-l’œil de la géographie ». Géoconfluences [revue en ligne].
- Di Méo, Guy. 2002. « L’identité : une médiation essentielle du rapport espace / société ». Géocarrefour, n° 77, p. 175-184.
- Epstein, Renaud. 2016. « Le “problème des banlieues” après la désillusion de la rénovation ». Métropolitiques [revue en ligne].
- Fassin, Didier. 2010. « Ni race ni racisme. Ce que racialiser veut dire », p. 147-172 in Didier Fassin (dir.). Les nouvelles frontières de la société française. Paris, La Découverte.
- Gaudin, Solène. 2015. « L’espace politico-médiatique de la rénovation urbaine ». Urbanités [revue en ligne].
- Gintrac, Cécile et Mekdjian, Sarah. 2014. « Le peuple et la “France périphérique” : la géographie au service d’une version culturaliste et essentialisée des classes populaires ». Espaces et sociétés, n° 156-157, p. 233-239.
- Goffman, Erving. 1975 [1963]. Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Paris, Éditions de Minuit.
- Grignon, Claude et Passeron, Jean-Claude. 2015 [1989]. Le Savant et le Populaire : misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature. Paris, Seuil.
- Guillard, Séverin. 2016. « Le rap, miroir déformant des relations raciales dans les villes des États-Unis », Géoconfluences [revue en ligne].
- Guillard, Séverin. 2016. Musique, ville et scènes : localisation et production de l’authenticité dans le rap en France et aux États-Unis. Thèse de doctorat de Géographie, Université Paris-Est.
- Guillard, Séverin. 2017. « "Getting the city on lock" : imaginaires géographiques et stratégies d’authentification dans le rap en France et aux États-Unis ». L’Information géographique, vol. 81, n° 1, p. 102-123.
- Hoggart, Richard. 1970 [1957]. La Culture du pauvre. Essai sur le style de vie des classes populaires en Angleterre. Paris, Éditions de Minuit.
- Jounin, Nicolas. 2016 [2014]. Voyages de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis dans les beaux quartiers. Paris, La Découverte.
- Kery James. 2017. À Vif. Arles, Actes Sud.
- Kirszbaum, Thomas (dir.). 2015. En finir avec les banlieues? Le désenchantement de la politique de la ville. La Tour-d’Aigues, Éditions de l’Aube.
- Léonard, Thomas. 2015. « L’intensification du stigmate des “banlieues” lors du processus pénal. Le cas de la métropole lilloise (2000-2009) ». Urbanités [revue en ligne].
- Lepoutre, David. 1997. Cœur de banlieue. Codes, rites et langages. Paris, Odile Jacob.
- Palsky, Gilles. 2004. « Carte ». Hypergéo [encyclopédie en ligne].
- Piolet, Vincent. 2016. « Le hip-hop comme élément identitaire dans le 9-3 ». Hérodote, n° 162, p. 125-134.
- Ndiaye, Pap. 2009 [2008]. La Condition noire. Paris, Gallimard.
- Noiriel, Gérard. 2006. Introduction à la socio-histoire. Paris, La Découverte.
- Plumauzille, Clyde et Rossigneux-Méheust, Mathilde. 2014. « Le stigmate ou la "différence" comme catégorie utile d’analyse historique ». Hypothèses, n° 17, p. 215-228.
- Poiret, Christian. 2011. « Les processus d’ethnicisation et de raci(ali)sation dans la France contemporaine : Africains, Ultramarins et “Noirs” ». Revue européenne des migrations internationales, vol. 27, n° 1, p. 107-127.
- Ravier, Thomas. 2003. « Booba, ou le démon des images ». La Nouvelle Revue française, n° 567.
- Ravier, Thomas. 2012. « Dancefloors d’asphalte ». La Nouvelle Revue française, n° 601.
- Ripoll, Fabrice et Rivière, Jean. 2007. « La ville dense comme seul espace légitime. Analyse critique d’un discours dominant sur le vote et l’urbain ». Annales de la recherche urbaine, n° 102, p. 121-130.
- Ripoll, Fabrice. 2012. « Attention, un espace peut en cacher un autre ». Actes de la recherche en sciences sociales, n° 195, p. 112-121
- Rivière, Jean et Tissot, Sylvie. 2012. « La construction médiatique des banlieues. Retour sur la campagne présidentielle de 2007 ». Métropolitiques [revue en ligne].
- Rivière, Jean. 2013. « Sous les cartes, des habitants. La diversité du vote des périurbains en 2012 ». Esprit, n° 393, p. 34-44.
- Robine, Jérémy. 2013. « Problème des banlieues : de quoi parle-t-on ? », p. 132-133 in L’Atlas des villes, Le Monde - La Vie.
- Robine, Jérémy. 2016. « Le 9-3, symbole du ghetto dans la nation ». Hérodote, n° 162, p. 55-72.
- Roussel, Yves. 1995. « Le mouvement homosexuel français face aux stratégies identitaires ». Les Temps modernes, n° 582, p. 85-108 (pdf).
- Roman, Joël. 2013 [2007]. Eux et Nous. Paris, Fayard.
- Sedel, Julie. 2013 [2009]. Les Médias et la Banlieue. Lormont, Le Bord de l’eau.
- Sedel, Julie. 2014. « La “banlieue” des journalistes : les dessous d’un lieu commun ». Métropolitiques [revue en ligne].
- Stébé, Jean-Marc. 2010 [4e édition]. La Crise des banlieues. Paris, PUF.
- Stock, Mathis. 2006. « Construire l’identité par la pratique des lieux », p. 142-159 in De Biase, Alessia et Rossi, Christina (dir.). “Chez nous”. Territoires et identités dans les mondes contemporains. Paris, Éditions de la Villette [Disponible en archives ouvertes].
- Tissot, Sylvie et Poupeau, Franck. 2005. « La spatialisation des problèmes sociaux ». Actes de la recherche en sciences sociales, n° 159, p. 4-9.
- Veschambre, Vincent. 2005. « Penser l’espace comme dimension de la société. Pour une géographie sociale de plain-pied avec les sciences sociales », p. 211-227 in Raymonde Séchet et Vincent Veschambre (dir.). Penser et faire la géographie sociale. Rennes, PUR [disponible en édition ouverte].
- Vieillard-Baron, Hervé. 1994. Les Banlieues françaises ou le ghetto impossible. La Tour-d’Aigues, Éditions de l’Aube.
- Vieillard-Baron, Hervé. 2000. « De l’effroi technique à la peur des banlieues ». Histoire urbaine, n° 2, p. 171-187.
- Vieillard-Baron, Hervé. 2006. « La banlieue au risque des définitions », Géoconfluences [revue en ligne].
- Vieillard-Baron, Hervé. 2011 [2e édition]. Banlieues et périphéries. Des singularités françaises aux réalités mondiales. Paris, Hachette.
- Wacquant, Loïc. 1992. « Pour en finir avec le mythe des “cités-ghettos”. Les différences entre la France et les États-Unis ». Annales de la Recherche urbaine, n° 54, p. 21-30.
- Wacquant, Loïc. 2005. « Les deux visages du ghetto. Construire un concept sociologique ». Actes de la recherche en sciences sociales, n° 160, p. 4-21.
Pour en savoir plus
Chansons de Kery James évoquées dans l’article.
- Banlieusards, 2008 (voir le clip).
- Lettre à la République, 2012 (voir le clip).
- Zyed et Bouna, 2015 (voir le clip).
Présentation de la pièce « À Vif » par le Théâtre du Rond-Point (Paris).
- Page de présentation
- Dossier de presse (pdf)
- Dossier pédagogique (pdf)
Tribune de Kery James dans le journal Le Monde :
- Kery James, « Lutter contre les violences policières n’est pas que le combat des Noirs et des Arabes », Le Monde, 17 février 2017.
Par l’auteur du présent article, sur le même sujet :
- Communication intitulée « La Banlieue : géosymbole de l’exclusion sociale et urbaine » (9 mars 2015) lors de la semaine « Après janvier 2015, s’exprimer contre la terreur » organisée par des élèves de l’ENS Ulm : [enregistrement audio].
- Article dans une revue étudiante, qui reprend en substance l’argumentation de la précédente communication : Burgel, Élias. 2016. « “La Banlieue, c’est pas rose…” : penser “la Banlieue” après les attentats de janvier 2015 ». OpiumPhilo, n° 4, p. 39-43.
Élias BURGEL
élève de l’École normale supérieure de Paris (ENS Ulm), diplômé du master d’histoire de l’École doctorale de Sciences Po
Mise en web : Jean-Benoît Bouron
Pour citer cet article :Élias Burgel, « "Banlieusard et fier de l’être" : Kery James, ou le retournement "à vif" du stigmate spatio-symbolique », Géoconfluences, 2017. |



 Mode zen
Mode zen